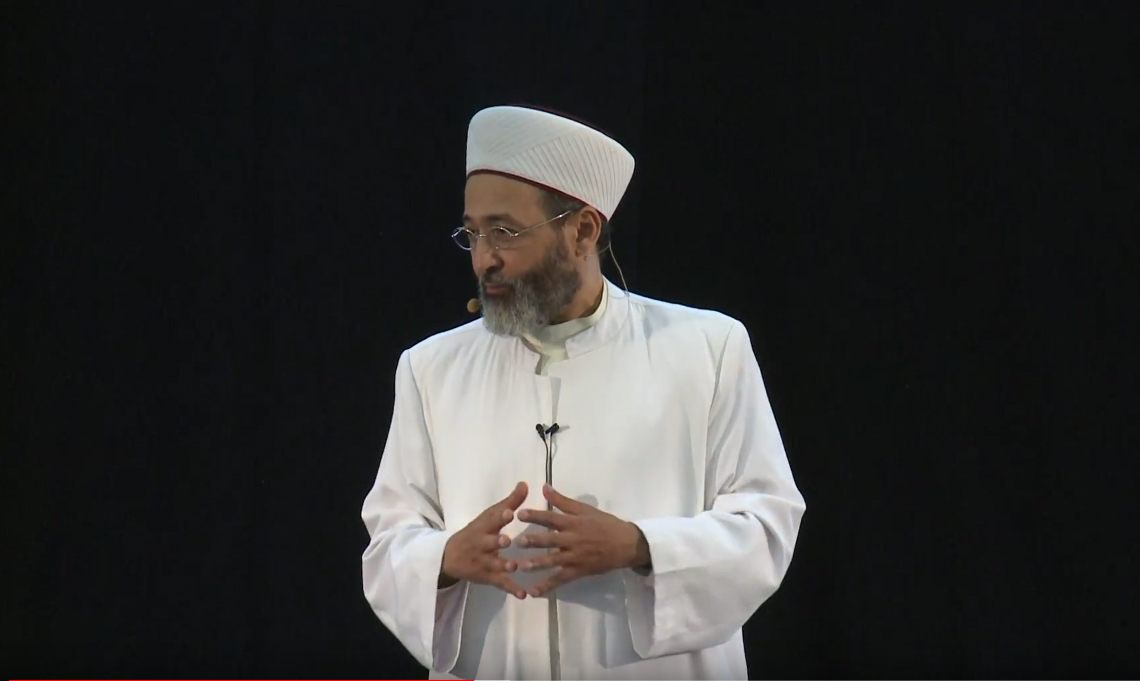Nous n’allons pas reprendre à notre compte la catégorisation canonique médiévale trop générale et qui revient à subdiviser -selon des approches différentes et selon les courants juridiques classiques de l’islam- le monde en trois parties : le monde de l’islam (dâr el islâm), le monde non musulman hostile (dâr el harb) et le monde non musulman en paix (dâr el-‘ahd). Rappelons que ces notions ne sont évoquées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Aujourd’hui, cette compartimentation des territoires et du monde ne répond pas à la nouvelle configuration géopolitique où les pays et les peuples sont organisés selon le modèle politique de l’Etat-nation, lequel modèle est né à partir du XIXe.
Cependant, le principe de catégorisation des territoires et des pays par les juristes musulmans classiques n’était pas dénué d’une certaine pertinence, laquelle n’a pas été perçue par certains auteurs musulmans qui ont proposé comme catégorie géothéologique modernes tantôt dar ad-da‘wa (terre de prédication) tantôt dar ach-châhâda (terre de témoignage). Ce qui est au fond signifie la même chose à quelque nuance près. Or que l’on soit en terre d’islam ou non, cela ne change rien quant à ce rapport à la prédication et au témoignage.
Ces deux catégories passent à côté de l’intention des premiers canonistes et juristes qui qualifiaient un pays « non musulman» non selon la tâche religieuse qu’auraient à y accomplir les musulmans (comme prédicateurs ou témoins de leur foi) mais en fonction des caractéristiques politiques objectives marquantes du pays en question, pour en tirer par la suite des effets normatifs spécifiques. En effet, le fait de qualifier l’Occident de terre de la da‘wa (prédication) ou de la chahâda (témoignage) ferait de la da‘wa et de la chahada une condition morale et canonique de permission et de légitimation de la présence des musulmans en Europe. Or le musulman n’a pas à avoir une mission de da‘wa et avoir l’intention de témoigner de sa foi. Il n’est pas obligatoire canoniquement pour les musulmans ni d’être prédicateurs actifs ni même de témoigner passivement de leur foi, c’est-à-dire avoir l’intention et le souci de communiquer leur religion aux autres, d’une façon ou d’une autre. Par contre ils ont l’obligation de se conformer dans la mesure du possible aux enseignements de leur religion. Et c’est cette condition qui intéresse essentiellement les canonistes classiques en examinant la possibilité pour le musulman ou non de pratiquer sa religion en « territoire non musulman ».
Quant à la da‘wa, seul un Envoyé de Dieu (Rasûl) a l’obligation théologico-canonique de l’exercer, même le simple prophète, nabî, n’a pas cette mission[1]. Et si la prédication ou le témoignage restent conformes à l’esprit de l’islam, ils le sont en tant qu’acte surérogatoire. Ils ne sont pas obligatoires ni une condition de résidence parmi les non musulmans. La prédication et le témoignage demeurent à ce titre valables à titre facultatif même en pays musulmans, à condition que ceux qui pratique la prédication en remplissent les conditions, en maîtrisant les règles de la hisba, laquelle fonction religieuse canonique consiste, après avoir étudié le fiqh avec tous ses courants pour pouvoir prôner le bien et à prohiber le mal (al-‘amr bi al-ma‘rûf wa an-nahye ‘ane al-munkar), en connaissance de cause. C’est à cet égard que dar da’wa et dar chahada perdent ici leur pertinence.
Aussi la raison de la catégorisation canonique classique est-elle d’ordre pratique et non dogmatique. Selon le statut du pays ou du territoire, l’interprétation de la loi et la façon d’élaborer des fatwas, et donc l’orthopraxie, change en fonction de la nature du contexte. C’est cet enseignement qu’il faudrait retenir de la subdivision médiévale du monde en dar al-islam, dar al-‘ahd et dar al-harb. Elle n’est pas théologique, car les dogmaticiens ou théologiens musulmans s’occupent eux d’autres territoires intérieurs, ceux des croyances, et dont la frontière métaphysique est tracée par l’orthodoxie, par la doctrine de la foi.
Quant aux juristes classiques musulmans, ce qui les intéressait c’est le contexte sociétal, juridique, politique (guerre, paix..) qui détermine le rapport des musulmans aux pratiques de la sharia. Ce sont les notions de paix, de liberté et de la sécurité qui sont souvent évoquées. Les hanafites l’avaient bien compris et explicitement exprimé. Abu-Hanifa, lui-même, fondateur du hanafisme, considère en substance que le pays est qualifié de « terre d’islam » (dar al-islam) si le musulman peut y accomplir ses pratiques religieuses en toute liberté, sans être inquiété[2]. Et là où il y a l’insécurité le territoire en question quel qu’il soit même majoritairement musulman prend le statut « terre d’incrédulité » (dar al-kufr). Il faut noter ici que le mot « islam » signifie dans ce répertoire taxinomique hanafite la sécurité (al-’amne) et la paix, et le mot kufr signifie l’insécurité (al-khawf). Cette catégorisation médiévale reste alors d’une grande actualité, même si certains détails développés par les hanafites et les autres courants canoniques ont été discutés et restent discutables.
On comprendrait dès lors pourquoi j’évoque la « condition laïque » ou « terre laïque » pour qualifier canoniquement notre contexte français. Je reprends à mon compte le même paradigme classique des fuqaha-s, hanafites notamment, pour lui donner encore plus de précision et plus de densité. Cet aspect laïc devra nous importer comme caractéristique notoire de la République française pour penser la visibilité légale de l’islam à travers la sharia. En résumé, il s’agira de la grande question de la sharia et/dans la sécularisation. Notre problématique canonique est donc bien sériée.
Ceci étant et au-delà de la sophistication sémantique que l’on pourrait proposer pour qualifier la situation des musulmans en Occident, l’Europe et notamment la France est d’abord une terre de prospérité économique, d’égalité, de démocratie, de liberté, de sciences, de savoir… et c’est pour cela que les musulmans (migrants, étudiants…) sont venus de leur pays d’origines. Ils n’avaient pas besoin de canonistes pour leur donner cette autorisation, qui relève de la nécessité universelle et du bon sens. La question de la légitimité de cette présence ne se pose plus, mais plutôt celle de la visibilité de l’islam dans un pays sécularisé comme la France. La « théologie de la réalité » comme rapport normatif nu et sans a priori à un réel effectif nous oblige à composer avec notre contexte tel qu’il se présente, et sans nous engager dans des conjectures fictionnelles futuristes. L’impératif religieux résidera alors dans l’établissement d’un cadre théorique pour une pratique d’un islam fidèle à ses sources, assimilant dans sa conceptualisation une réalité marquée par la laïcité. Une lecture de l’islam autour duquel tous les musulmans de France, quelles que soient leur diversité ethnique ou leur tradition d’origine, peuvent se constituer en communauté spirituelle non ségréguée dans un quelconque espace marginal de la société. Le communautarisme étant banni par le modèle politique français. Au sein de cette communauté, les individus sont liés à la République dans son unité et indivisibilité -aujourd’hui on insiste plutôt sur la diversité dans l’unité de la République- par le contrat de citoyenneté, lequel aux yeux de la sharia est un contrat moral à honorer[3]. Adhésion à une communauté religieuse et à une citoyenneté française, telle est la double appartenance que doit assurer notre conceptualisation de la sharia en France.
Aussi est-il fréquent dans les discours islamiques en France d’affirmer que l’islam n’est pas incompatible avec la laïcité[4]. Certes, mais cela ne doit pas signifier pour autant qu’ils aient les mêmes fondements, les mêmes finalités ni la même vision du monde. L’islam est une religion et une spiritualité. La laïcité quant à elle relève du répertoire de la philosophie politique. Cette appréciation vaut également pour le judaïsme et le christianisme. Vivre dans un régime de laïcité ne consiste pas non plus à reproduire l’expérience catholique, protestante, orthodoxe, juive ou bouddhiste[5]. Chacune de ces religions élabore son rapport spécifique au religieux, dispose de ses propres références, et donc chacune a sa visibilité et son expression propres dans l’espace public laïc[6]. La compatibilité entre l’islam et la laïcité française se limite dans leur articulation, leur rencontre, selon des modalités qui nécessitent des accommodements rendus possibles grâce à leur dynamisme respectif. Un avantage reste certain, c’est que les musulmans de France n’appartiennent à aucune Eglise transnationale ni ne sont liés sacralement à une quelconque « terre promise » à laquelle elle doivent allégeance politico-religieuse. Ils appartiennent à une religion et non à une ethnie, à une spiritualité et non à un système politique d’origine. L’islam à ce titre est doublement décentralisée quant à l’appartenance nationale de ses adeptes et à la lecture théologico-canonique qu’ils pourraient en avoir. L’islam est donc par nature gallican.
Pour aborder et préciser la question de la pratique musulmane et de son adaptabilité à la condition laïque française nous nous sommes permis d’employer la notion de « sharîa de minorité »[7].
[1] Si l’on revient à la définition du Prophète en islam nous en avons deux typologies. Le Prophète qui reçoit la Révélation mais n’a pas l’obligation de la transmettre, c’est le simple Prophète (Nabiy) ; et celui qui a l’obligation de la transmettre, c’est le Messager (Rasul).
[2] Al-KASÂNÎ, badâ’i‘e as-sanâ’i‘e, dar al-kutub al-‘ilmiyya,1997, Beyrouth, t.9, p.519.
[3] Coran 5, 1 ;16, 91 ; 17, 34. Concernant le statut des musulmans dans une situation de minorité où le destin des musulmans est lié à celui du reste de la Nation, Muwaffaquddine b. Qudâma (mort en 620 de l’hégire), une sommité du hanbalisme, énonce avec clarté cette règle morale que nous devons faire nôtre : « Il ne nous –musulmans- est permis en aucune façon- minoritaires ou majoritaires- de faillir à nos engagements envers des non musulmans avec lesquels nous cohabitons en paix. Faillir à nos engagements quelles que soient les raisons n’est pas de notre religion » (Muwaffaquddin Ibn QODÂMA, El-mougny, t.10, Beyrouth, Edition Dâr el-kitâb el-‘araby, 1983, p. 515-516- c’est une édition en grande taille et en 14 volumes avec deux volumes index). Abu-baker Ibn El-Arabi, le grand malikite se réfère à un titre d’un chapitre de Bukhary intitulé « la faute qui consiste à trahir une personne, qu’elle soit elle-même intègre moralement ou non » (bâb ithm el-ghâdiri bi el bar iwa el-fâjer) – voir BUKHÂRI, Fath el-bâry, t. 6, K. 58, B. 22, p. 422 ; les hadiths correspondants sont numérotés de 3187 à 3189 ; il souligne : « Même dans le cas où les musulmans subiraient une trahison, ils ne doivent en aucun cas rendre une trahison par une trahison, ni une lâcheté par une autre » (Abu-baker IBN AL-ARABI, Ahkâmou el-Qor’ân, t. 1, p. 277). Cet avis repose en effet sur un hadith du Prophète explicite et formel qui dit : « Rends le dépôt à celui qui t’a fait confiance, et ne trahit guère même celui qui t’a trahi » (El-Hâkim via Anas, El-moustadrak, op. cit., t. 2, p. 46). C’est cette attitude éthique profondément musulmane qu’il faut réaliser en donnant à notre citoyenneté un contenu moral exigeant.
[4] Cette laïcité demeure assez floue dans certains de ses aspects pratiques. Les effets simultanés d’une privatisation progressive des convictions, l’émergence de ce qu’on appelle les « nouvelles sectes » d’une part, la perte d’influence des Eglises historiques, notamment le catholicisme d’autre part, ont déstabilisé les lectures juridiques traditionnelles du phénomène religieux qui étaient jusqu’alors limitées aux cultes reconnus (catholiques, protestants- réformés ou luthériens- et juif). Les interprétations philosophiques et juridiques doivent désormais prendre en considération les nouveaux bouleversements qui traversent la France et la nouvelle donne religieuse.
[5] Il ne nous est pas interdit d’être informé de leurs expériences, voire même de nous en inspirer.
[6] Les services publics en France sont déconfessionnalisés. Aucune religion ni idéologie philosophique quelconque ne doit marquer de sa particularité le fonctionnement et l’organisation de l’Etat et de ses institutions publiques. C’est un acquis irréversible et une constante de la laïcité. Ces mêmes services publics ainsi que leurs agents, fonctionnaires de l’Etat, doivent respecter l’obligation de neutralité alors que l’usager, le citoyen, reste libre d’y exprimer ses opinions religieuses. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans l’affaire dite des foulards islamiques dans son arrêt n°130394, de novembre 1992.
[7] Cette terminologie risque d’être très contestée comme elle peut être universellement adoptée. J’ai cherché en vain dans la littérature des canonistes anciens comme dans celle des modernes pour essayer de trouver si quelqu’un avant moi avait eu recours à ce type de concept de « sharî’a de minorité », que l’on peut aussi appeler sharî’a relative. Il se peut que j’ai laissé échappé un auteur ; en tout cas rien ne saurait, pour moi, avoir moins d’importance qu’une revendication de priorité pour cette terminologie.
«SHARIA DE MINORITÉ» : RÉFLÉXION POUR UNE INTÉGRATION CANONIQUE DE L’ISLAM EN « TERRE LAÏQUE ».
TAREQ OUBROU
«SHARIA DE MINORITÉ» : RÉFLEXION POUR UNE INTÉGRATION CANONIQUE DE L’ISLAM EN « TERRE LAÏQUE ».