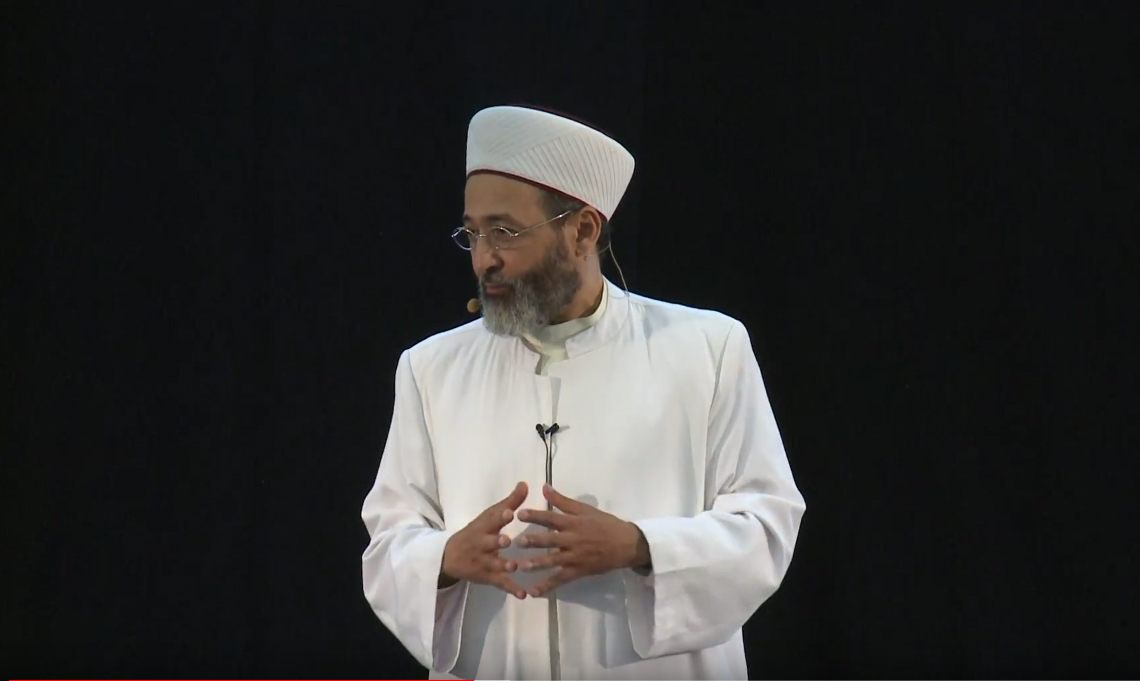L’Occident malgré son émancipation de la domination religieuse et sa sécularisation forte reste marqué par une épistémè (Foucault) chrétienne. La censure et l’interdit sont parmi ces notions encore chargées d’une connotation théologique. Elles en ont gardé quelques traces bibliques subliminales, même si leur usage aujourd’hui est bien laïcisé.
Qu’en est-il de ces notions dans l’univers et le répertoire théologico- philosophico-éthique de l’(I)islam
Rappelons de prime abord que l’islam est une religion qui s’inscrit dans le sillage des religions monothéistes révélées, notamment le judaïsme et le christianisme. Le Coran, son Texte fondateur est le prolongement et la continuité des Anciennes Écritures. Il reprend fréquemment des récits de la Bible, mais s’en démarque souvent quant à leur détail.
Une archéologie scripturaire de l’interdit
La Genèse, notamment « le péché originel », est parmi les sujets repris par le Coran, exposé différemment. Il donne une matière pour une autre théologie de l’interdit, qui paraît moins angoissante pour la conscience morale du croyant.
L’arbre interdit du Coran n’étant pas décrit, il ne pourrait toutefois être celui de la connaissance, notamment celle du mal et du bien. Il affirme contrairement à la Bible que le premier rapport établi entre Dieu et Adam était celui de l’enseignement de la connaissance justement, pas son interdiction. En effet, après la création d’Adam, le Coran informe que Dieu lui apprit les noms de toutes choses – c’est-à-dire le langage comme traduction de la pensée et donc signifiant sa capacité de connaître ou de reconnaître les choses- avant de demander aux Anges de le saluer pour ce savoir qu’il porte, et qui leur fait défaut . L’interdit n’est venu que par la suite, celui de faire et non celui de savoir. La limite morale tracée par cette interdiction d’approcher l’arbre selon cette perspective n’est que l’épreuve de la liberté de choisir, acquise à juste titre par cette même connaissance.
Mais le plus notoire dans le récit coranique, c’est que la faute fut introduite par le désir de faire le bien. En effet l’Homme selon le Coran est initialement et ontologiquement bon : « Nous avons créé l’homme dans la meilleure constitution (ahçani taqwîm ) », affirme le Coran. Cet Attribut divin, ihsân, comme accomplissement, comme création de ce qu’il y a de mieux et de meilleur (ahsan), ne touche pas uniquement à la constitution physique mais désigne également une création spirituellement et moralement accomplie et parfaite . Il reste prédisposé à accomplir le mal certes, mais c’est le bien ontologique qui est gravé dans sa prime nature. La chute vient incidemment sauf s’il se redresse . C’est généralement dans la voie vers le bien que la faute vient s’introduire. On ne fait jamais le mal sciemment. On le fait lors de la confusion, l’oubli, la colère, dans des situations d’inadvertance, de faiblesse… Autrement le mal n’est pas ontologique à la nature humaine mais accidentel. C’est ce que Satan avait compris en leur suggérant de faire un bien pour devenir éternels pour rester à côté de Dieu et pour être deux Anges car les Anges ne désobéissent pas à Dieu . Ils sont tombés dans la confusion, qui est la seule arme de Satan. Leur faute fut dans le moyen, pas dans l’intention.
Aussi, Eve n’était-elle pas responsable du péché d’Adam, elle n’était pas l’envoyée de Satan à Adam, comme le souligne le récit de la Genèse. En effet, ce récit a souvent été reçu comme une information sur une nature négative qui caractériserait la femme comme alliée historique et naturelle du Diable. Le récit coranique, quant à lui, ne donne aucun espoir à cette lecture théologique de la femme : les deux péchèrent au même titre, nous dit le Coran. Eve n’était pas plus étourdie qu’Adam. L’homme et la femme devant le choix de faire le bien ou le mal sont ex æquo.
Finalement, cette histoire est banale dans la mesure où elle ne débouche sur aucune théologie particulière concernant le péché, si ce n’est à propos du statut élevé auprès de Dieu auquel Adam et Eve n’auraient pu accéder sans cette chute. Car il fut suivi d’un repentir qui leur a permis de découvrir une autre face de Dieu. Il n’y a pas non plus de sanction, tel que l’enfantement dans la douleur pour Ève, par exemple. Le Coran parle plutôt d’un rapprochement privilégié qui s’est accompli après la chute . Ce qui a permis à certains théologiens et mystique musulmans de considérer que leur état moral et spirituel s’éleva encore plus haut qu’avant la faute. Celle-ci a constitué un éloignement ponctuel qui leur a permis par la suite d’apprécier la proximité retrouvée, car on n’estime certaines choses à leur juste valeur que lorsqu’on les perd. La séparation éveille ici la conscience pour mieux apprécier le don. En effet, la chute a fait sortir Adam et Eve de la banalité de l’existence, d’une jouissance relative sans mérite, pour les faire entrer dans l’aventure, la dualité et le contraste d’un monde dans lequel Dieu se manifeste à travers Ses multiples Attributs, un monde qui permet de mieux apprécier la jouissance finale, bien méritée, celle du Paradis éternel final, où la rencontre et la connaissance de Dieu atteindra son apothéose.
Aussi Adam et Eve n’ont-ils pas transmis de péché, puisque celui-ci fut absous par le repentir, avant leur sortie du Paradis et donc avant qu’ils n’aient d’enfants . Ils n’ont donc eu de descendance que dans un état spirituel vierge de tout péché. « Celui qui se repent est comme celui qui n’a jamais péché » , affirme le Prophète. Désespérer du Pardon (al-marfira) et de la Miséricorde (ar-rahma) de Dieu : c’est le péché. Adam et Éve n’y sont pas tombés.
Leur imputer la responsabilité de l’expulsion de leur progéniture du Paradis, dans cette perspective, n’a pas de sens ici, car leurs enfants n’ont jamais vécu dans ce Paradis, étant déjà destinés, selon le Dessein de Dieu, à vivre dans l’épreuve terrestre. Rien au monde n’aurait changé ce Destin. Pourquoi alors se lamenter sur le sort de l’humanité et accuser Adam et Eve, qui n’ont mangé le fruit de l’arbre qu’une seule fois dans leur vie, alors que nous en consommons sans cesse ? Leur nature n’est-elle pas la même que la nôtre ?! La morale de cette histoire selon le Coran est donc ailleurs.
Nous comprenons dès lors la théologie chrétienne qui, en donnant à Jésus le statut de Sauveur, d’Agneau pascal et de celui qui a vaincu la mort causée par cette faute originelle, a paradoxalement renforcé la caractère de celle-ci en la rendant plus déprimante : une dette qui restera de toute façon pensante, avec un sentiment de culpabilité permanent.
Cette association entre le péché et la mort n’existe pas dans le Coran. Adam et Eve étaient conscients qu’ils n’étaient pas éternels, c’est pour cette raison qu’ils ont mangé de l’arbre pour le devenir justement. L’occasion nous est donnée ici de commenter une parole du Prophète qui nous rapporte un dialogue mystique et métaphysique entre Adam et Moïse : « Adam et Moïse débattirent. Moïse dit : « Toi, Adam qui es notre père, tu nous a déçus, car tu nous as fait sortir du Jardin ». Adam lui répondit : « Tu es Moïse, que Dieu a honoré par Sa parole et pour qui Il a écrit la Torah, comment oses-tu me reprocher une chose que Dieu a écrite quarante ans avant-même qu’Il ne me crée ? » Et le Prophète Mohammed de commenter : « Et Adam eut raison de Moïse, et Adam eut raison de Moïse » » .
Ce qui va nous importer, dans ce Texte, ce n’est pas son aspect théologique en rapport à la question du Destin (al-qadar), sixième pilier du credo de la foi musulmane, et qui n’est pas notre objet ici, mais les termes de cette disputation. Tout d’abord Moïse n’a pas reproché à Adam d’avoir péché, car il sait que le péché -à ne pas confondre ici avec le mal- est naturel. Lui-même ayant connu la faute . Il lui a reproché surtout les conséquences matérielles du péché , chose qu’Adam attribue à Dieu, à sa Science, à son Pouvoir, à son Dessein et à son Destin : comme un père qui aurait perdu sa richesse à cause d’une erreur de gestion, mais qui n’aurait eu de progéniture qu’après sa faillite. Les enfants n’auront jamais connu la richesse pour lui reprocher leur chute dans la pauvreté. Ce sont les parents qui souffrent de la pauvreté car ils ont goûté au confort de la richesse. De leur péché, ils se sont repentis, et par le repentir ils en ont été affranchis. C’est pour cette raison que les moralistes avérés mettent en garde contre le fait de mépriser le pécheur, même si sa faute reste condamnable. Dans le droit musulman, en effet, on sanctionne le criminel ou le délinquant, mais moralement on ne porte jamais de jugement ontologique de valeur négative à son propos, et encore moins à propos de sa descendance, de ses proches, de son ethnie ou de sa communauté. C’est cette vision de la faute individuelle, qu’il faut distinguer du fauteur lui-même et de sa famille, qui correspond à l’esprit juste de la morale.
Ce que le Coran veut que l’on retienne de cet événement, c’est l’enseignement évoqué dans le passage suivant : « Ô fils d’Adam ! Que Satan ne vous tente pas comme il a fait sortir vos parents du Jardin… » . Toute la moralité de l’histoire peut se résumer dans ce passage. Il s’agit d’éviter l’erreur des parents : vouloir faire le bien en tombant dans la faute. Et si erreur et faute il y a eu, l’exemple qu’ils nous ont donné reste à suivre. Le repentir efface la faute. C’est pour cette raison entre autres que le péché originel ne constitue pas ce poids pesant sur la conscience morale musulmane.
Nous mesurons par conséquent à travers cette démarcation du récit coranique par rapport à celui de la Bible les conséquences théologiques qui pourront en découler concernant la faute et donc le statut théologique de l’interdit et de la censure.
L’interdit, une règle ou une pédagogie ?
Même si le sens théologique de l’interdit n’est pas toujours le même, il reste une exception pour la Bible comme pour le Coran : un seul arbre interdit parmi une multitude d’autres. Il délimite ainsi une certaine frontière nécessaire, mais pas trop contraignante.
Il faut dire aussi que la philosophie du « tout permis », si elle existe vraiment, n’est pas moins angoissante que celle du « tout interdit ». Il faut donc un juste équilibre qui donne une fonction à la censure, sans la rendre absurde, arbitraire, coupée de toute raison et de toute sagesse. Elle doit être à l’avantage de l’Homme et de la société.
Certes, l’impunité et la négligence sont inévitablement des fléaux pour un Etat, mais le grand art de la vie en société consiste aussi à discerner quand la loi impose retenue et sanction et quand la persuasion seule agira. Car si toutes les actions, bonnes ou mauvaises, sont détaillées et rationnées, que deviendrait alors la vertu sinon un vain mot. Il faut dire également que l’absence de tout interdit non seulement tue la morale, l’éthique, mais la liberté elle-même et donc la responsabilité. Elle élimine également la jouissance qu’elle prétend défendre, et pousse ainsi la perversion à des limites toujours extrêmes, sans atteindre définitivement la jouissance totale, laquelle deviendrait un mirage et s’éloignerait dès qu’on s’en approcherait. L’instinct de transgression étant inscrit dans la nature humaine, l’interdit selon cette optique théologique n’est que préventif, une sorte de ceinture de protection pour ne pas aller trop loin dans l’enchaînement des transgressions, ce qui supprimerait en définitive le désir et le plaisir. C’est ce que les juristes musulmans malikites médiévaux ont appelé : « interdiction préventive » saddu adh-dhrâ’i‘e, ou « principe de précaution ». Un concept aujourd’hui à la mode.
Certains ne reconnaissant pas la sagesse derrière la Providence divine la critiquèrent parce qu’elle laissa pécher Adam et Eve. Or en leur donnant la raison et le savoir, Dieu leur a donné la liberté de choisir, car la raison n’est que choix, sinon ils seraient tous deux des êtres artificiels, des marionnettes.
Même sans la référence à Dieu, l’Homme livré à lui-même s’est toujours créé des interdits, des autocensures. La preuve en est que nos sociétés pourtant émancipées de la morale religieuse et des Écritures ne cessent de voter des lois d’interdiction. La constitution Française vient d’introduire tout récemment dans son texte le principe de précaution. Cela signifie qu’à un moment donné, il faudrait donc bien tracer une limite, qui est souvent pédagogique, préventive, et non punitive. En effet, aux libertés s’opposeront toujours des libertés. Et si tout ce qui est possible deviendrait souhaitable alors régnerait le désordre.
Aussi chaque société a ses complexes, ses tabous, ses territoires moraux inviolables et ses interdits non-dits. Selon l’histoire, la religion, les valeurs… de chaque société, des limites infranchissables naissent spontanément à travers une autocensure collective consentie. La censure culturelle, non dite, est à cet égard plus forte qu’un interdit imposé par le droit. Elle est encore plus violente symboliquement que le droit écrit, car elle travaille la conscience collective morale et creuse le sentiment de l’interdit en profondeur.
L’exemple de l’inceste illustre cet état de fait. Hormis quelques États (la Suisse et l’Autriche par exemple) l’inceste entre deux adultes consentants n’est pas criminalisé. Le code pénal ne lui réserve aucune peine, pourtant son interdiction morale est très forte dans les consciences.
Si l’interdit est inévitable, l’excès de censure est contre-productif. Il excite le désir de la transgression et augmente le délit. Quant au vice, il ne sera pas éradiqué par la censure systématique, car sa forme se déplace et se métamorphose en fonction de la censure elle-même, qui parfois lui sert d’instrument et de support pour de nouvelles expressions. Et la censure devient alors la nourrice du vice. Car interdire une chose est susceptible de suggérer une mauvaise pensée jusqu’alors enfouie ou ignorée, et inciterait à l’infraction. Il semble alors préférable d’autoriser une poignée de bonnes actions que d’interdire une tonne de mauvaises actions. L’avènement d’une seule personne vertueuse est plus appréciable que la contrainte de dix vicieux.
Aussi, même si l’on bannit tous les objets du désir, même si l’on enferme les gens dans la discipline la plus sévère qui puisse s’exercer dans un monastère ou une zawiyya (son équivalent soufi), on ne saura rendre chastes et droits ceux qui n’y sont pas entrés tels, tellement il faut de soins et d’éducation pour bien réussir cette entreprise. Prenez tous les biens d’un cupide, vous ne lui arracherez jamais sa cupidité.
Dans le récit du péché originel, la Providence divine selon le Coran nous commande la tempérance, la justice, la continence, la modération… nous met devant une profusion d’objets désirables mais en nous armant d’un esprit qui pourrait errer au-delà de toute limite et satiété. Essayer de supprimer tous ses objets sous prétexte qu’ils pourraient nous égarer serait contraire au plan de Dieu. Vouloir expulser la faute de la sorte équivaudrait à expulser la vertu. Leur objet est le même, chasser cette dernière c’est chasser alors les deux ensemble.
C’est pour cette raison que le Coran n’opte pas pour une multiplication des interdits. Il va même jusqu’à déconseiller aux croyants de poser des questions sur la loi . Le Prophète eut la même attitude en mettant en garde de poser des questions sur les détails de la loi et provoquer ainsi la Révélation qui viendrait avec un interdit. « Le pire parmi vous est celui qui par sa question provoque une interdiction » a-t-il dit . En effet, toute codification excessive ou énonciation massive de lois même sous la pression de la demande risque d’armer finalement la résistance à toute autorité, même s’il s’agit de Dieu lui-même. C’est pour cette raison que l’on peut parler d’autocensure divine : un Dieu qui s’abstient de dire tout ce qu’il sait, ces paroles étant infinies . Toute vérité ne doit pas être dite et dans n’importe quelle circonstance. L’Imam Ali disant : « Parlez aux gens selon leur intelligence, sinon ils ne croiront ni en Dieu ni en son Prophète » .
Parlant de cette pédagogie divine, Ibn Taïmiyya disait : « la Loi ne fut communiquée en bloc, mais conformément à la sagesse qui dit que « Si tu veux être obéi demande le possible…» . Il disait aussi « il y a de ces questions dont la seule réponse est le silence, exactement à la méthode du Coran… » . En effet, plusieurs fois le Coran esquive des questions inappropriées ou prématurées ; et parfois attire l’attention du questionneur sur ce qui est le plus important.
Le droit de savoir sans limite ni tabou :
Il n’y a pas d’institution musulmane centralisée qui détiendrait l’interprétation infaillible de l’Écriture. Seul le Texte s’impose à la conscience religieuse musulmane. Le savoir est universalisé en chaque croyant manifestant un esprit de recherche. L’orthodoxie et l’orthopraxie de l’islam à cet égard ne pouvaient, en ce sens, être qu’extensives et inclusives. Tout le monde est appelé à lire et à comprendre.
Le Coran incite en effet à la réflexion et invite le lecteur à user de sa raison, comme lumière intérieure. Celle-ci est censée rejoindre harmonieusement celle de la Révélation. «Lumière sur Lumière (nûrune ‘alâ nûr)» , dit le Coran. Le Coran s’adresse à ceux qui sont dotés de raison (ulî an-nuhâ ou ulî al-‘albâb ). «Parmi ses signes la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs, c’est là un signe pour les gens qui réfléchissent» souligne-t-il. Il appelle aussi au refus du mimétisme et du suivisme aveugles des ancêtres .
S’il n’y a plus de Révélation après le Coran, c’est tout simplement parce que l’Homme est mature désormais. Informé sur sa raison universelle, il devra compter sur lui-même et continuer sa marche existentielle, intellectuelle, morale, spirituelle… sans attendre le secours d’une nouvelle Révélation. Voilà le sens de la clôture de la Révélation avec l’avènement du dernier Prophète, Mohammed.
Le grand juriste Izz Ad-dîne Abd As-Salâm appelé « le sultan des oulémas » a bien compris cet esprit ouvert et universel que le Coran a inauguré quand il a dit que : « Les gens (i.e. les savants musulmans) font des lois en fonction de chaque époque » . Ils auront donc les lois qu’ils méritent.
Nous comprenons dès lors que la sortie de la clôture scripturaire ne signifie pas une sortie de l’islam. Puisque les significations de la vérité se trouvent aussi dans l’universel, la raison…
Le musulman est invité à chercher la vérité dans le Coran. Il doit parallèlement la chercher dans le livre cosmique, celui du Monde sensible et intelligible. Il est aussi invité à la sonder au fond de sa propre conscience : «Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu’à ce que la vérité leur apparaisse?!» ; «Dans la terre il y a des signes pour ceux qui ont acquis la certitude, et en vous-mêmes, n’observez-vous pas ?! » … Les versets du Coran qui ouvrent à l’esprit du croyant des horizons infinis de la connaissance sont nombreux.
On a donc la possibilité de concevoir l’islam comme une religion qui peut théologiquement être lisible en y reconnaissant l’effet d’une cause (Dieu) qui agit métonymiquement à travers le Coran et la Nature. En même temps, une démarcation intellectuelle s’impose pour parer à une identification de Dieu au Coran et/ou à la Nature, dans le sens où Il serait tout sauf Transcendant, confondu ontologiquement avec Sa parole révélée et/ou avec la Nature. Cela donne une grande marge de manœuvre à l’interprétation et à la liberté intellectuelle du croyant puisque Dieu, en islam, n’est pas venu par lui-même à notre monde, comme l’établi le dogme chrétien, mais est resté à distance. Le ciel ne s’est pas confondu avec la terre, ni Dieu avec l’homme. C’est une sécularisation théologique qui permet au croyant musulman d’être plus à l’aise dans son approche de la Parole de Dieu qui ne s’est pas faite chair mais tout simplement Écrit. À cet égard l’islam est non seulement une religion du Texte, mais surtout celle de la réflexion et de l’interprétation. Les montagnes de livres d’exégèse produits par les musulmans au fil de l’histoire confirment cette posture et ce profil scripturaires. On citera à titre d’exemple, le livre d’exégèse du Coran d’Abu-alhasan Al-Achaarî en 500 volumes et celui d’Ibn-Al-Arabi en 80 volumes, chaque volume comptant 2000 feuilles, sans parler de multiples autres ouvrages d’exégèse.
Vue sous cet angle, la pensée musulmane n’est pas exclusive, dans la mesure où la soumission aux Écritures n’est pas antinomique à l’herméneutique dans l’objectif d’émanciper la connaissance et de lui ouvrir des horizons universels. Certaines méthodes utilisées pour étudier la nature (sciences exactes) et la culture (sciences humaines) ne sont pas exclues, si l’on admet que l’islam dans toutes ses dimensions n’est pas toujours lisible uniquement et immédiatement à partir des Écritures. Cela veut dire que le fait d’établir a priori une théorie de lecture qui s’intéresse au sens des Textes en même temps qu’à leur vérité, n’a jamais été écartée, car la démarche musulmane cognitive ne s’arrête pas au niveau autocentré sur le Texte (Coran ou Sunna). C’est ce qu’ont compris très tôt les Anciens (salaf). Ils bâtirent un grand édifice de connaissances de toutes sortes, des plus religieuses aux plus rationnelles scientifiques. La sécularisation musulmane, tout en respectant une forme de distinction et de démarcation entre l’humain et le divin, et tout en étant consciente que l’interprétation du sacré ( Le Coran) n’est pas sacrée, n’a pas créé une rupture radicale entre les deux registres : le spirituel et le temporel ; la raison et la Révélation. À ces époques où l’ijtihad était une culture répandue, un savant digne de ce nom n’était reconnu comme tel que lorsque qu’il avait maîtrisé les connaissances religieuses et les connaissances rationnelles et universelles de son époque.
Une chose est certaine dans la tradition musulmane, la connaissance intellectuelle, théorique ou fondamentale ne doit pas connaître de limite, ni principe de précaution. Aucune censure ne peut s’ériger en barrière contre la connaissance et la quête du savoir. L’histoire du Moyen Âge de l’islam le montre très bien. Les premiers musulmans ont forcé et enfoncé toutes les portes de la connaissance. Aucune limite n’a été respectée. Ici, la transgression fut souhaitable et quasi totale. Connaître pour connaître telle est la destinée première de l’être humain. Explorer toutes les connaissances sans censure ni interdit. On n’a pas connu dans l’histoire musulmane des autodafés pour brûler des ouvrages scientifiques, philosophiques ou théologiques d’autres Traditions, sous prétexte qu’ils contredisaient les enseignements de l’islam.
Alors qu’au Moyen Âge occidental, l’étude des lois de la nature était censurée par l’Église, les musulmans ont découvert les lois de l’optique, de l’astronomie, ont développé la médecine…, ont lu et commenté la philosophie grecque. C’est grâce à eux que la scolastique chrétienne a vu le jour avec Saint Thomas d’Aquin, justement par l’introduction de la philosophie grecque à travers les ouvrages, entre autres, d’Averroès, théologien, juriste et philosophe musulman.
L’histoire des conquêtes musulmanes ne nous rapporte aucune destruction des œuvres intellectuelles et même artistiques des peuples conquis. Les Compagnons du Prophète, on ne peut plus orthodoxes, ont conquis l’Égypte à l’époque du deuxième calife Omar, mais n’ont jamais détruit ni livres ni œuvres artistiques. Les statues qui se trouvaient autour et à l’intérieur des Pyramides furent préservées…
Les musulmans de ces époques respectaient presque religieusement tout savoir et toute œuvre et ne brûlaient pas de livre, même frivole. Ils savaient que cela priverait des esprits subtils et intelligents d’en extraire des joyaux intellectuels. En effet, un sage en fera meilleur usage qu’un sot des Écritures sacrées.
Il fallut attendre les Talibans pour déclarer la guerre aux statues de Bouddha alors qu’elles avaient été préservées jusque-là par les musulmans, depuis l’aube de l’islam. Cette situation est pathétique, car elle donne l’impression que les musulmans sont en train de régresser et de sombrer dans leur propre Moyen Âge. Leur modernité étant en effet derrière eux. À cette époque c’étaient les musulmans qui subissaient la destruction de leurs œuvres. C’est d’ailleurs l’une des raisons du déclin de leur civilisation, entre autres raisons. L’invasion des Mongols et la reconquête de l’Espagne furent un de ses moments qui inaugurèrent ce déclin. Les Mongols, qui jetèrent des tonnes d’ouvrages (Théologie, philosophie, médecine, physique…) dans le fleuve du Tigre, lequel resta noire d’encre pendants des jours et les catholiques, avec la reconquête d’Espagne, l’autre barbarie qui commença d’abord par brûler les livres avant même l’Inquisition.
Mais l’autre moment symptomatique du déclin de la pensée musulmane -le pire car endogène aux musulmans eux-mêmes- fut celui de l’interdiction de l’imprimerie par les Ottomans au XVIe, alors que l’Occident était en train de s’émanciper des censures de l’Église romaine. Et depuis, le monde musulman n’a cessé de marcher à l’envers. Et cela continue jusqu’aujourd’hui avec ces crispations qui s’aggravent de plus en plus de peur de mettre en péril une orthodoxie et une orthopraxie, qui sont en définitive plus fragilisées par les ignorances et la défaite intellectuelle des musulmans, que par les productions intellectuelles et artistiques de l’Occident.
De la censure de l’image, du théologique à l’éthique.
C’est de la notion de Révélation de Dieu qu’il faudrait partir pour comprendre l’enjeu de l’image en islam. L’épiphanie du Dieu de l’islam est une révélation à distance, car Dieu ne se révèle pas, il se révèle par une Parole. Contrairement à l’Incarnation chrétienne comme représentation de Dieu en Christ qui fonde un « croire » qui passe par le « voir », et donc par l’image , la foi en islam s’effectue plutôt par l’audition (as-sam‘e) et par la lecture (al-qirâ’a, d’où le nom qur’âne, Coran).
L’islam, comme le judaïsme puis le protestantisme par la suite, reste théologiquement aniconique.
Disons ici qu’en terme herméneutique l’image reste univoque dans la mesure où elle ne donne pas le même recul que permet une parole ou un texte. Pour être plus univoque que le Texte, l’image fut écartée moins par une interdiction prescriptive que préventive.
L’image donne de l’émotion ; la parole permet plus de méditation ; l’écrit lui, propose l’interprétation.
Nous voyons bien aujourd’hui l’usage qu’en fait la télévision. Une fois l’image même combinée à la parole elle finit par imposer sa logique émotionnelle, même si la parole qui l’accompagne est plus nuancée et plus rationnelle. On voit plus l’image qu’on entend son commentaire, comme si la vision suspendait l’audition. C’est à ce titre que l’herméneutique de l’image est plus difficile que celle du Texte.
Il est vrai que l’image a constitué une controverse en islam, mais sans jamais atteindre le conflit et la violence de l’iconoclasme chrétien, vécus pendant la période chrétienne du premier (730-787) et du second iconoclasme (813-843), que l’on qualifie parfois d’inspiration et d’impulsion musulmane, mais sans en être vraiment certain. La troisième vague est venue au XVIe siècle avec le protestantisme.
La Représentation de Dieu étant écartée, le débat sur l’image en islam ne relève pas de la dogmatique mais de l’éthique, plus précisément de ce fameux principe de précaution (saddu adharâ’i‘e) déjà évoqué. Il n’y a dans le Coran aucune mention à l’interdiction des images. C’est dans la Tradition du Prophète que l’on trouve un ensemble de Textes qui interdisent les représentations des êtres vivants en général. Cette interdiction a fait l’objet d’interprétations. Certains commentateurs ont limité cette interdiction aux sculptures et non pas aux dessins, à des images qui ont des formes ; d’autres ont permis la sculpture d’une partie seulement de l’être vivant et pas sa totalité. Il faudrait souligner que cette interdiction de la sculpture s’explique par le contexte idolâtre du moment coranique ou les statues avaient pour fonction essentielle de représenter des divinités. Certains hadith (paroles du Prophète) justifient l’interdiction par le fait de vouloir imiter Dieu dans le sens de vouloir l’égaler dans sa création, ce qui serait une sorte de défi lancé à Dieu Lui-même. Ce qui ferait sortir ce comportement du registre de l’éthique à celui du théologique et du dogmatique, comme une non conformité plus à l’orthodoxie qu’à l’orthopraxie. Vouloir être au même niveau que Dieu lui-même en prétendant être capable de créer aussi mais une création factice, dont il manque l’âme qui fait la vie de ces œuvres, est la raison essentielle de cette interdiction. C’est pour ce motif que le hadith ( parole) du Prophète explique que le Jour du Jugement dernier Dieu demandera à ces sculpteurs d’insuffler l’âme dans ce qu’ils ont sculpté pendant leur vivant et ils ne pourront le faire . C’est aussi pour cette raison que certains ont permis de se limiter à sculpter le buste, c’est à dire une partie du corps qui ne peut être vivante d’une manière autonome dans la réalité.
Mais dans l’histoire, nous trouvons que les musulmans n’ont pas fait de ces interdictions, qu’elles soient d’ordre dogmatique ou éthique, un vrai problème. On a même vu des savants parmi les plus orthodoxes, faire des sculptures, un Qarafî (m.1285), savant et canoniste malikite, a lui-même reconnu avoir sculpté en cire, un lion dont les yeux changeaient de couleur chaque heure, et un homme montant le chandelier au moment de la première prière de la journée dans l’attitude d’un muezzin, faisant l’appel. Lui-même comptait imiter un artisan qui, avant lui avait sculpté un homme en miniature, qui dès le fajr ( la première prière canonique de l’Aube) se manifestait et prononçait, par voix artificielle, une salutation pour réveiller le sultan Ayoubite de l’époque – XIIIe siècle. Mais il n’avait pu lui donner la voix, comme cet artisan du sultan.
Donc ce type de sculpture se pratiquait sans faire de scandales. Bien sûr dès qu’on veut représenter le Prophète, cela devient plus sensible, justement pour une raison préventive, mais surtout émotive. Mais en général l’islam, comme d’autres Tradition, reste rétif aux représentations dites sacrés et très hostile au fétichisme car il conduit à l’idolâtrie.
collectif publié à Harmattan dont le titre est : CENSURE ET LIBERTÉS : ATTEINTE OU PROTECTION ?
Colloque organisé en partenariat avec le centre de recherche Droits et sociétés religieuses (D.S.R) et L’Observatoire de la liberté de création 26-27 mars 2010- Sous la direction de Nathalie GOEDERT p.23-38.
Tareq Oubrou